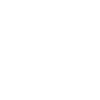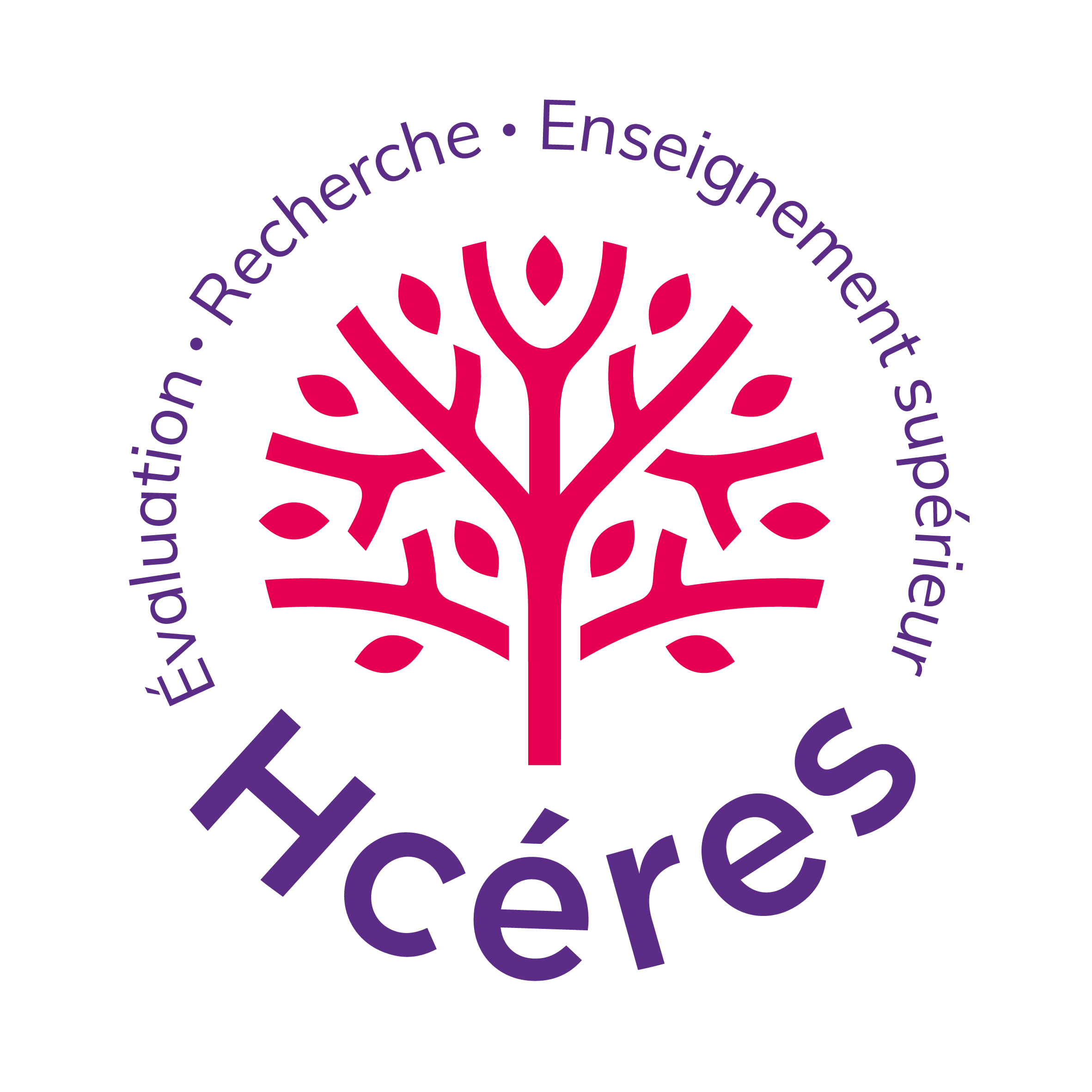Observatoire des sciences et techniques (OST)
Publication du rapport "La position scientifique de la France dans le monde et en Europe : analyse de différents corpus de publications et de projets européens"
Publié le
Le Hcéres publie un nouveau rapport de l'Observatoire des sciences et techniques (OST) sur "La position scientifique de la France dans le monde et en Europe : analyse de différents corpus de publications et de projets européens". Une synthèse des principaux résultats vient accompagner la publication.
Présentation du rapport
Ce nouveau rapport de l’OST sur la position scientifique de la France a deux grands objectifs. Le premier consiste à actualiser les analyses précédentes en s’appuyant sur deux types de données : les publications scientifiques et les participations aux programmes européens en faveur de la recherche, en particulier les projets du Conseil européen de la recherche (ERC). Le second objectif consiste à observer les publications de la France à partir de différents corpus : le plus large correspond à la base de publications de l’OST, un corpus est restreint aux publications en anglais et deux corpus sont constitués à partir de sélections de revues scientifiques. Il s’agit d’observer dans quelle mesure les indicateurs relatifs à la France changent selon le corpus, que ce soit pour l’ensemble des disciplines ou pour certains champs de recherche. L’originalité de l’approche réside dans la mesure de l’influence des corpus sur plusieurs composantes de la position de la France et pas uniquement sur un type d’indicateur comme le nombre de publications ou leur impact. L’analyse est notamment attentive aux domaines des SHS pour lesquels la question de la langue de publication revêt une importance particulière dans différents pays non anglophones. Toujours dans la perspective d’apprécier l’influence des corpus, quelques indicateurs sont calculés sur la base ouverte OpenAlex d’une part et sur l’archive française HAL d’autre part.
La première partie observe les publications scientifiques selon la langue. Elle présente l’évolution de la part de l’anglais et des autres langues à l’échelle mondiale, par grande discipline et pour les principaux pays de publication. Une comparaison avec la base OpenAlex est proposée à l’échelle agrégée. La deuxième partie examine la position de la France à partir de corpus plus ou moins sélectifs de publications. Elle souligne la spécificité des disciplines des sciences humaines et sociales, particulièrement en France. La troisième partie analyse la participation de la France aux programmes cadres de recherche de l’Union européenne. Elle compare le profil disciplinaire de la France dans le corpus des projets du Conseil européen de la recherche avec son profil dans les publications. La conclusion souligne que la position scientifique d’un pays varie selon les corpus de façon différenciée selon les caractéristiques considérées et propose d’approfondir la démarche en mobilisant plus largement des bases de publications ouvertes. Sept annexes présentent les sources de données et méthodes utilisées, ainsi que des données complémentaires à des niveaux de nomenclature plus fins ou sur les revues retenues dans les corpus mobilisés.
Principaux résultats
La position scientifique de la France : actualisation des analyses précédentes et apports des différents corpus
La part des publications de la France en anglais augmente, y compris dans différentes disciplines de SHS, tout en restant au-dessus de la moyenne mondiale ; à un niveau équivalent à l’Allemagne.
L’érosion de la part mondiale de publications de la France se poursuit, y compris en comparaison de certains pays intensifs en recherche. La part mondiale de la France est plus favorable au sein du corpus des revues les plus citées. Les indicateurs d’impact sont un peu plus favorables au sein du corpus anglais (notamment en SHS), mais variables selon les disciplines au sein du corpus des revues les plus citées. Globalement, l’écart avec l’Allemagne se réduit un peu au sein des corpus anglais et revues les plus citées ; la position relative par rapport à l’Espagne ou l’Italie est plutôt meilleure sur au moins l’un des corpus.
À l’échelle mondiale, entre 2010 et 2022, les publications en informatique ont connu la plus forte croissance, devant la recherche médicale. Parmi les 11 grandes disciplines, la physique a vu le nombre des publications fléchir, alors que les sciences sociales font partie des disciplines les plus dynamiques. Dans ce contexte, le profil disciplinaire spécifique de la France par rapport à différents pays intensifs en recherche perdure, mais varie un peu selon les corpus. La forte spécialisation en maths est confirmée dans le corpus anglais et la spécialisation modérée en informatique un peu augmentée. La spécialisation en sciences humaines disparaît et la non spécialisation en sciences sociales est accentuée. Le profil disciplinaire de l’Allemagne est plus équilibré et moins sensible au passage au corpus en anglais.
Au niveau des grands domaines de recherche, le profil disciplinaire de la France mesuré à travers les publications converge avec l’observation des candidatures et projets financés à l’ERC.
Perspectives d’approfondissement pour comprendre l’évolution de la position de la France
Les analyses sur différents corpus apportent des enseignements et répondent à des demandes de certaines communautés. Les analyses sur des ensembles revues ou actes de conférences sélectifs intéressent par exemple les communautés en informatique ou mathématiques. Cette approche pourrait être développée, par exemple dans le domaine de l’IA.
De même, des analyses qui excluraient des revues considérées comme prédatrices ou dans la zone grise (annexes dans le rapport). Les typologies de publications (évaluation par les pairs, audience nationale ou internationale) développées par des pays du nord de l’Europe pourraient être considérées par la France.
La question de l’évolution du profil disciplinaire de la France en comparaison d’autres pays et des dynamiques mondiales mériterait d’être approfondie.