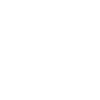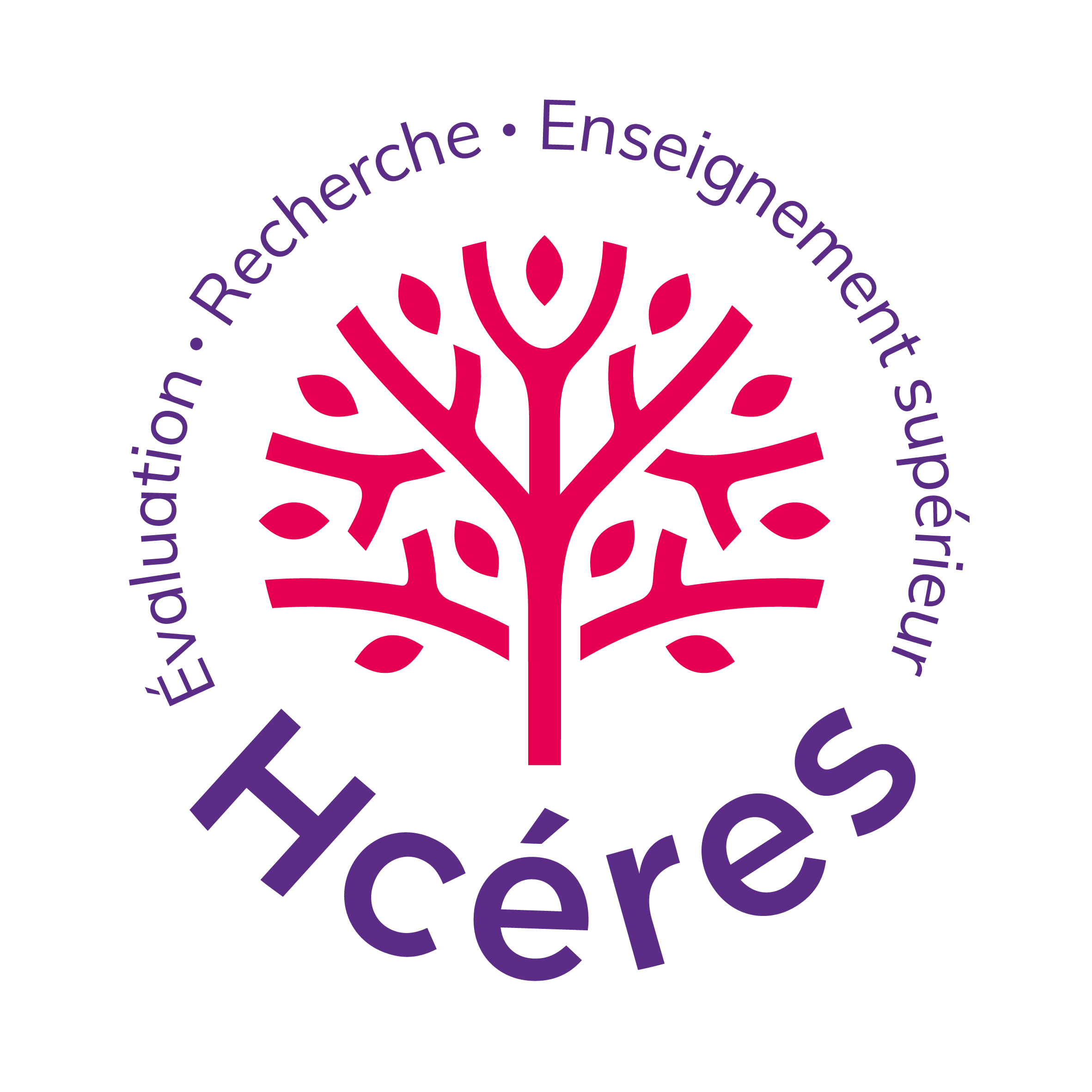Évaluation, Publications
Publication du rapport d'évaluation de l'Institut Pasteur
Publié le
Le rapport d’évaluation de l’Institut Pasteur, rédigé en anglais, est rendu public sur le site internet du Hcéres.
Il s’agit de la première évaluation de l’Institut Pasteur organisée par le Hcéres. L’évaluation a été réalisée par un comité d’évaluation international composé de 8 membres reconnus pour leur excellence scientifique et leur expérience de management de grandes institutions de recherche (cf composition in fine). Le rapport d’auto-évaluation de l’Institut Pasteur a été préparé entre juin 2023 et janvier 2024, et la visite d’évaluation a eu lieu en juin 2024. Le rapport d’évaluation a été finalisé en décembre 2024. Sa publication a été différée jusqu’à ce jour pour éviter la coïncidence avec la publication du nouveau plan stratégique de l’Institut, « Pasteur 2030 ».
***
Le comité d’évaluation a reconnu que l'Institut Pasteur jouit d'une réputation bien établie en tant qu'institution de recherche de pointe dans le domaine de la santé, avec un historique solide en termes de contributions scientifiques importantes.
Le contenu du rapport d'évaluation peut être résumé comme suit :
- Recherche et politique scientifique
Tout en reconnaissant que l'Institut Pasteur jouit d'une très grande réputation d'excellence scientifique au sein de la communauté internationale, le comité d'évaluation a examiné attentivement la manière dont l'Institut réalise - ou non - tous ses efforts pour maintenir la qualité de sa recherche au plus haut niveau international. Le comité fait un certain nombre de suggestions pour améliorer encore les processus internes d'évaluation de la recherche de l'Institut, et il encourage celui-ci à améliorer sa capacité à mesurer l'impact scientifique de sa recherche et à développer des comparaisons avec les principales institutions de recherche européennes et internationales. Le comité recommande également à l'Institut de clarifier la vision de son rôle, de développer des synergies entre ses quatre missions - recherche, formation, santé publique et innovation - et de mettre l’accent sur un petit nombre de priorités stratégiques dans des domaines où il est bien placé pour apporter des contributions majeures, à savoir les maladies à transmission vectorielle et les maladies infectieuses.
- L'Institut Pasteur dans la société
Au-delà de la recherche, le rapport passe en revue les activités de l'Institut Pasteur qui contribuent à son impact sur la société. Il s'agit notamment de sa contribution à la santé publique, avec une attention particulière portée aux contributions de l'Institut dans la crise du Covid-19, et à ses travaux et projets sur le développement de vaccins. Le comité a également examiné l'implication de l'Institut dans des projets d'innovation et des partenariats avec des entreprises privées, dans des activités de formation et dans le partage des connaissances scientifiques avec la société. Le comité d'évaluation salue la qualité de l'engagement de l'Institut dans ces activités et formule un certain nombre de suggestions pour en améliorer encore l'impact.
- Position et partenariats en France, en Europe et à l'international
Le comité d'évaluation a examiné la position de l'Institut Pasteur dans le contexte national. Il recommande que l'Institut s'appuie sur son engagement récent en faveur d'un partenariat fort avec l'Université Paris Cité, et que les deux partenaires définissent une stratégie commune ambitieuse. Il suggère à l'Institut d'accroître son ouverture et ses partenariats, de clarifier sa position dans les domaines de la recherche et de la santé en France, et d'améliorer sa capacité à contribuer aux politiques gouvernementales dans ces domaines. En ce qui concerne le niveau européen, le comité se félicite du succès croissant des équipes de l'Institut dans les programmes de recherche européens au cours des cinq dernières années, mais il considère que l'Institut Pasteur devrait développer une stratégie ambitieuse pour agir en tant que leader européen dans le domaine de la santé. Par ailleurs, le comité d'évaluation reconnaît que la reconfiguration du réseau Pasteur - avec une nouvelle gouvernance, une nouvelle stratégie et de nouveaux modes de fonctionnement - est un atout majeur qui peut permettre à l'Institut - dans son nouveau rôle au sein du réseau - d'être plus performant en matière de recherche et de santé publique à l'échelle mondiale.
- Gouvernance, organisation, gestion et fonctionnement
Les équipes de recherche de l'Institut Pasteur bénéficient d'un soutien de très grande qualité, mais l'organisation interne apparaît complexe et, dans une certaine mesure, fragmentée. L'allocation des moyens pourrait faire l’objet d’un processus moins centralisé et mieux utilisé. Ces facteurs internes ont limité la capacité de l'Institut à mettre en œuvre sa stratégie, et des réformes internes contribueront à mener l'Institut Pasteur vers de futurs succès : l'Institut devrait améliorer la définition des objectifs et le suivi des actions menées pour les atteindre, impliquer davantage de scientifiques dans la définition des objectifs et des priorités, et décentraliser la gestion. Le comité d'évaluation salue certaines réalisations remarquables de la politique des ressources humaines, telles que le soutien au développement professionnel des jeunes scientifiques, mais il note également que l'Institut Pasteur n'est pas entièrement préparé à relever le défi des nombreux départs à la retraite de chercheurs seniors dans les années à venir ; l'Institut doit améliorer sa capacité à attirer des scientifiques de haut niveau, en milieu de carrière ou au niveau senior. Enfin, la viabilité financière est un problème bien identifié : l'Institut devrait améliorer sa gestion budgétaire, à la fois pour la prévision et le suivi des dépenses, et accroître la couverture des coûts des activités de recherche financées sur contrat.
Le comité d'évaluation a identifié 7 recommandations principales destinées à renforcer l'Institut Pasteur et son développement futur. Il a également identifié les principales forces et faiblesses de l'Institut.
Recommandations principales
- Recommandation 1 : engager une réflexion sur les principales missions de l'Institut (recherche, innovation, formation et santé publique), réaffirmer ou redéfinir son positionnement et la manière dont il les exerce, et communiquer clairement sur ces orientations. Cela permettra d'assurer une meilleure adéquation entre ce que fait ou ne fait pas l'Institut Pasteur et la perception de son rôle par le public et les pouvoirs publics.
- Recommandation 2 : renforcer les efforts pour mener des recherches d’excellence au meilleur niveau mondial et se concentrer sur les domaines dans lesquels l'Institut Pasteur est bien placé pour apporter des contributions majeures.
- Recommandation 3 : mieux intégrer le management et le fonctionnement avec la stratégie scientifique, développer des indicateurs de performance qui permettent de mieux assurer la cohérence entre l'allocation des moyens et les ambitions scientifiques, tout en mesurant les progrès réalisés en termes de résultats, d'optimisation des ressources et d'impact sur la société.
- Recommandation 4 : amplifier l’orientation de l'Institut vers l'extérieur et son ouverture, et accroître ses activités en partenariat avec des organisations nationales et internationales. La combinaison de différents types d'expertise devrait permettre d'élargir le champ des découvertes et d'accroître les bénéfices pour la santé. Fort de son histoire, de sa stature et de ses qualités uniques, l'Institut Pasteur devrait assumer un rôle de coordination de projets de recherche européens dans des domaines majeurs.
- Recommandation 5 : poursuivre les réformes du réseau Pasteur déjà engagées vers un modèle de partenariat multilatéral et plus équitable. Encourager fortement les travaux communs sur la base d’objectifs scientifiques partagés et la mobilité des personnels entre les différents membres du réseau.
- Recommandation 6 : améliorer l’attractivité des postes de haut niveau pour les chercheurs internationaux et œuvrer en faveur d'un collectif plus ouvert, plus diversifié et plus inclusif afin d'élargir l'expérience et les compétences du personnel.
- Recommandation 7 : développer davantage la collecte de fonds et la commercialisation pour renforcer la viabilité financière et accroître la couverture des coûts des activités de recherche financées sur contrat.
Forces
L'Institut Pasteur dispose d'un ensemble d’atouts très impressionnant.
- L'Institut jouit d'une très forte notoriété, notamment d'une reconnaissance bien établie d’excellence scientifique au niveau mondial et d'une grande renommée dans la société française.
- Il a développé un soutien de très grande qualité aux équipes de recherche, dans tous les domaines.
- Il a également développé un parc de plateformes technologiques de pointe de premier plan, avec les compétences de haut niveau nécessaires pour les exploiter.
- Le personnel de l'Institut - et l'ensemble du personnel travaillant sur le campus - est fortement engagé, avec un niveau élevé de fierté et de sentiment d'appartenance.
- L'organisation de la recherche en petites équipes autonomes est vivante et dynamique, avec la création régulière de nouvelles équipes dirigées par des leaders nouvellement embauchés.
- Le réseau Pasteur est une plate-forme mondiale unique de coopération en matière de recherche, de formation, et de santé publique, et sa nouvelle stratégie est plus claire.
- L'Institut a un engagement fort et de longue date concernant l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, et il est fortement impliqué dans la science ouverte.
- Il bénéficie d'un modèle économique diversifié avec une collecte de fonds et un capital importants.
Faiblesses
Les faiblesses énumérées ci-dessous sont identifiées pour aider l'Institut à se développer davantage et à atteindre son plein potentiel. Plusieurs d'entre elles sont, d'une manière ou d'une autre, le « miroir » de certaines des forces énumérées ci-dessus.
- Il y a un certain manque d'ouverture - ou un certain risque d'insularité.
- Il serait utile de clarifier davantage la position de l'Institut dans le système de recherche français et dans le système de santé français, l'équilibre de son engagement dans ses quatre missions et leur continuum, et les principaux objectifs de sa stratégie. Cela contribuerait à clarifier et à améliorer son image aux yeux des autorités françaises, de ses partenaires et de la société dans son ensemble.
- L'Institut n'a pas formulé de stratégie claire pour affirmer son leadership européen dans certains domaines clés où il devrait être une référence.
- L'Institut dispose d'une organisation et d'une gestion internes complexes. Il devrait améliorer sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie et sa capacité à coordonner ses équipes de recherche et à les mobiliser dans des projets communs.
- L'Institut ne semble pas tout à fait prêt à faire face à la perspective de nombreux départs à la retraite de chercheurs confirmés dans les années à venir. Il sera important de veiller à ce que des mesures soient prises pour attirer des scientifiques en milieu de carrière et seniors.
- Le pilotage et la gestion du budget doivent être améliorés, tant pour la prévision des dépenses que pour leur suivi, au niveau annuel et pluriannuel, ainsi que la capacité à maîtriser le modèle économique des activités de recherche contractuelle.
Composition du comité d'évaluation
|