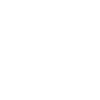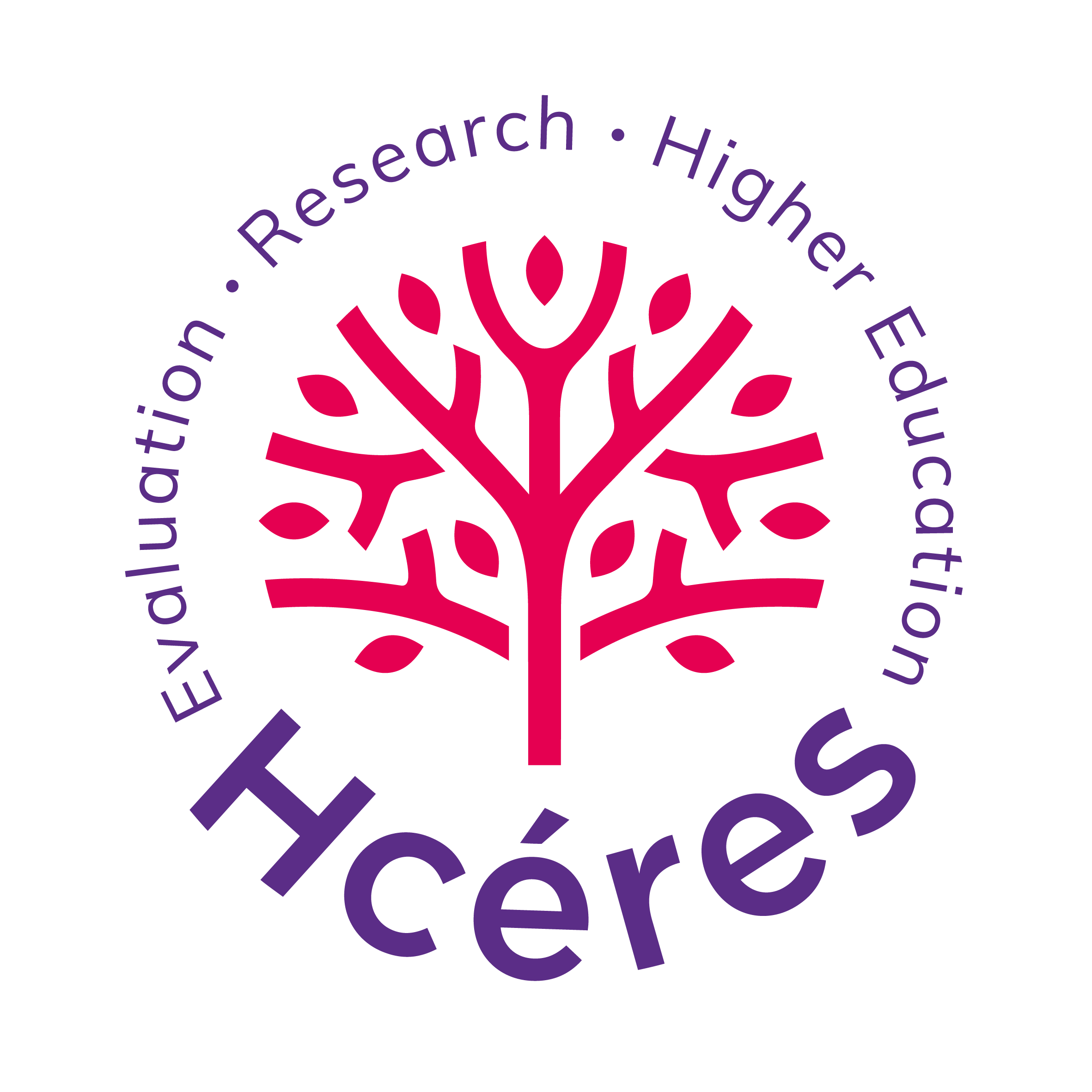Evaluation reports
FR

Université de Limoges
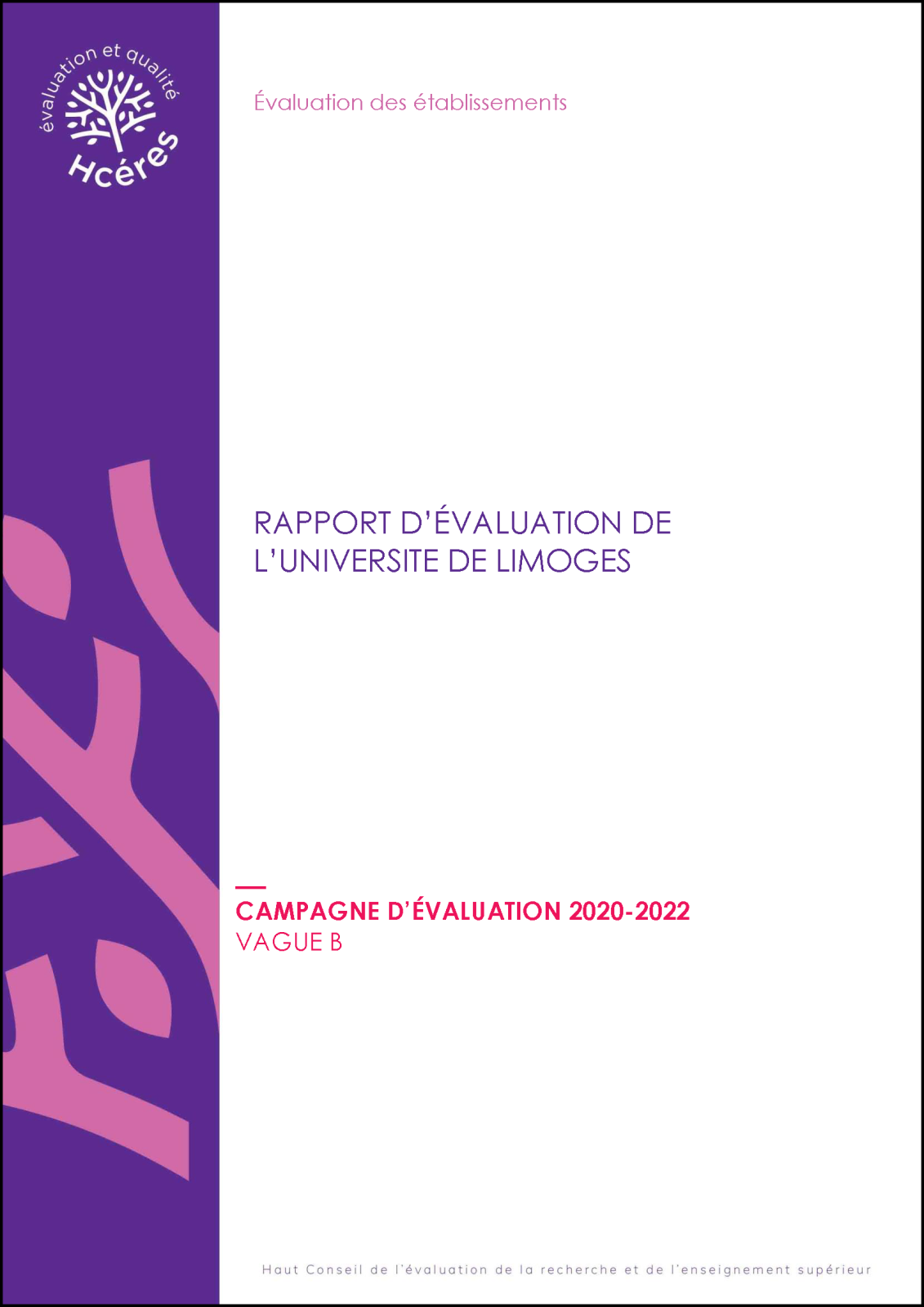
Observations du Président du Hcéres
L’évaluation de l’Université de Limoges a été conduite par un comité d’experts présidé par M. Thierry MONTALIEU, maître de conférences en économie, ancien administrateur provisoire de l’université d’Orléans.
L’environnement de l’Université de Limoges a connu dans les cinq dernières années de profonds bouleversements. La mise en place de la région Nouvelle Aquitaine a obligé l’université à sortir de la zone de confort que lui assurait sa position de monopole universitaire dans l’ancienne région Limousin, avec le bénéfice d’un contrat d’objectifs et de moyens assorti de dotations récurrentes et pluriannuelles. La dissolution de la COMUE Léonard de Vinci en 2022 après un premier recentrage infructueux sur Poitiers et Limoges, et l’échec de la SATT Grand Centre n’ont fait que rendre plus nécessaires la définition d’une nouvelle stratégie et la refondation des politiques partenariales.
Dans ce contexte, l’université a envisagé un schéma de rupture : un projet d’établissement public expérimental (EPE), inspiré de celui de Valenciennes, avec notamment un partenariat renforcé avec les grandes écoles et un INSA intégré associant formations d’ingénieurs et masters de sciences et technologies. Cette stratégie s’est heurtée à deux obstacles : elle a été rejetée d’abord par le réseau des INSA, puis lors des élections universitaires de 2020, devenues un véritable referendum sur la création de l’EPE. Ces élections ont conduit à l’arrivée d’une nouvelle gouvernance et à l’abandon du projet d’EPE et de restructuration des composantes. La nouvelle équipe s’inscrit dans une histoire universitaire plus traditionnelle et une organisation de l’établissement inchangée avec le risque, selon le comité, d’un maintien d’une organisation facultaire que les évaluations précédentes avaient recommandé de dépasser.
Cette situation conduit le comité d’experts à insister sur l’importance de la définition par la nouvelle gouvernance de son projet stratégique et de la déclinaison opérationnelle de celui-ci. C’est une attente forte de la région Nouvelle Aquitaine et une condition de son plein soutien. Il en va de même, note le rapport, des partenaires territoriaux de proximité. Ce besoin s’étend jusqu’aux partenariats internationaux qui selon les experts manquent de visibilité, faute d’une structuration suffisante.
Mais c’est surtout en vue de la mobilisation de la communauté universitaire – tant académique qu’administrative – que la clarification du projet et la définition de la trajectoire paraissent de la plus grande urgence. Après une période marquée par de profonds changements et de grandes interrogations, l’université manifeste à travers ses initiatives une volonté de transparence et d’apaisement. On peut certes comprendre cet objectif, mais il ne peut à l’évidence suffire. C’est pourquoi le comité recommande « d’agir rapidement et fortement pour que l’ensemble de la communauté d’établissement s’approprie les enjeux (diagnostic) et les orientations (stratégie) de l’université ». Il convient de fixer le cap, mais aussi de tracer le chemin.
Or le rapport d’évaluation fait état, à la période à laquelle il a été réalisé, de grandes faiblesses dans la capacité de l’établissement à se doter des outils nécessaires : absence de schémas pluriannuels (immobilier, numérique…), dispositif d’auto-évaluation lacunaire (gestion des données, définition des indicateurs, notamment sur la réussite et l’emploi des étudiants après la disparition de l’OVE…), fragilité des services support et des outils associés (soutien juridique, analyse des risques…), renforcement nécessaire des outils de pilotage et de contrôle interne dans une situation financière difficile, manque de culture procédurale, etc… Le comité dresse la liste impressionnante des chantiers à conduire. Il salue la volonté de l’université de rénover et de mieux structurer le dialogue de gestion avec les composantes, de même que ses efforts dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il n’en reste pas moins que la nécessité de disposer des outils nécessaires à l’action se révèle, après l’évaluation, aussi importante que la clarification stratégique des objectifs. En la matière, le comité, malgré la tension concernant le plafond d’emplois et la masse salariale, recommande de redéployer des moyens humains vers les services consacrés au pilotage, à l’aide à la décision et à la maîtrise des risques et de pousser plus avant la construction des nouvelles relations avec les composantes en clarifiant les périmètres de responsabilités de chacun, gouvernance et composantes.
L’université dispose pour conduire sa politique d’atouts que le comité met en lumière et qui constituent des points d’appui solides.
La recherche est en premier lieu un marqueur fort, qui, en dépit de certaines inégalités, a une bonne visibilité et bénéficie d’une organisation pertinente en cinq instituts capables d’une grande réactivité dans le cadre des appels à projets nationaux ou internationaux. La production scientifique est de qualité dans des champs précis ; le dispositif est complété par une valorisation performante et les liens avec les milieux industriels paraissent sérieux et durables. Un tel socle doit s’étendre selon le comité à l’ensemble des disciplines. Il doit permettre à l’établissement de resserrer le lien entre recherche et formation au moment où les formations doctorales reviennent sous la responsabilité de l’établissement, mais aussi de préciser la définition d’une véritable stratégie internationale.
Le comité salue en deuxième lieu la densité des relations pluridisciplinaires entre l’université et le CHU et l’ambition des actions coopératives : projet « Quartier de l’innovation » (Oméga Health) proche du CHU et rapprochant sur un site unique, dans l’environnement immédiat des entreprises et des structures de valorisation, des masters, des unités de recherche et la plateforme Biologie intégrative Santé Chimie Environnement (BISCEm) ; développement d’une recherche en santé, moteur d’innovations, et de travaux pluridisciplinaires associant souvent cliniciens et expérimentalistes et contribuant au montage de start-up ; création d’un « Campus des formations sanitaires » partenarial facilitant l’orientation et la réorientation des étudiants ; création du Centre de Simulation aux métiers de la santé LIMOUSIN (SIMULIM)…
L’université déploie en troisième lieu une politique volontaire pour associer les étudiants à la vie de l’établissement. Le comité souligne notamment le rôle très actif et l’ambition de la vice-présidence étudiante, notamment pour intégrer la transition sociétale et environnementale à la vie étudiante, valoriser l’engagement étudiant et soutenir une vie associative particulièrement riche. Le comité encourage l’établissement à consolider cette politique qui présente un ensemble original d’actions et il l’incite à veiller à créer un esprit fédérateur sur tous les sites. En matière pédagogique, l’université, malgré les contraintes financières liées au rééquilibrage budgétaire indispensable, souhaite développer une politique active d’innovation, d’interdisciplinarité, de formation tout au long de la vie et d’apprentissage, ce que le comité d’experts soutient particulièrement. Au rang des succès de l’université pour favoriser la réussite des étudiants, le comité signale en particulier l’effort louable de l’établissement pour différencier les parcours de formation afin de les adapter aux profils et aux rythmes d’acquisition variés de ceux qui étudient en son sein, ce qui a conduit à aménager quatre types de parcours : académiques (standards), rythme progressif (licence en quatre ans), excellence (rythme soutenu) et professionnalisant (élargissement à des stages et des expériences pratiques) et à développer également des diplômes universitaires répondant à la variété des besoins (Tremplin, Rebond, Réagir…).
Le Hcéres, au-delà des recommandations à l’établissement, suggère à l’État de veiller dans le dialogue contractuel à l’instauration par l’université de feuilles de route précises visant à mener à une bonne fin les divers chantiers indispensables, tels qu’identifiés par le rapport d’évaluation.