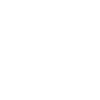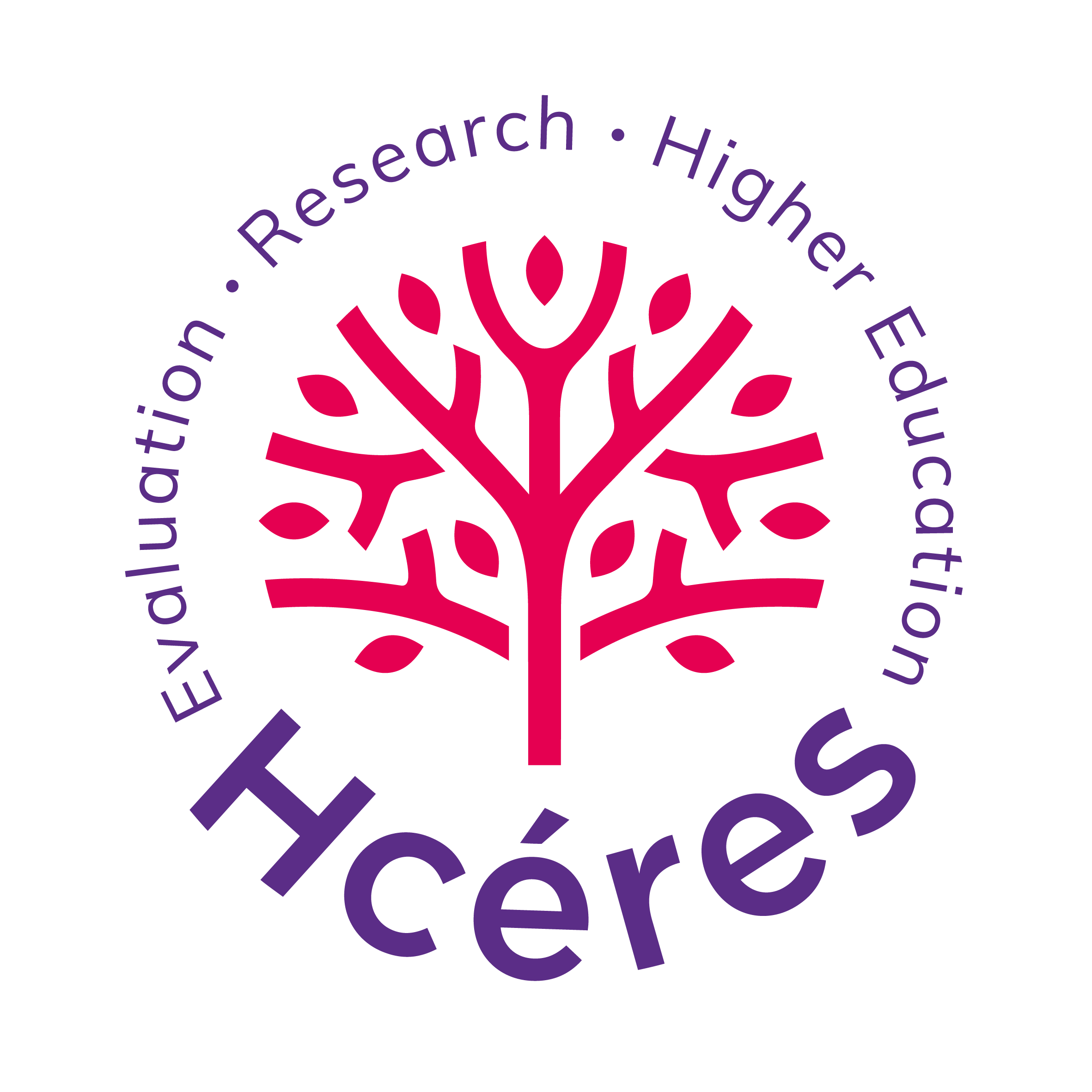Évaluation, Publications
Publication du rapport d'évaluation du Centre national d'études spatiales
Published on
Le rapport d'évaluation du Centre national d'études spatiales est rendu public sur le site internet du Hcéres.
L’évaluation a été réalisée par un comité d’évaluation composé de 8 membres français et européens reconnus pour leur excellence scientifique et leur expérience de management d’institutions de recherche ou d’agences de financement de la recherche.
- Didier Roux, ancien directeur de la recherche et du développement et de l’innovation du groupe Saint-Gobain, président du comité ;
- Aurélie Baker, directrice France d’Aiko ;
- Éric Dautriat, ancien directeur exécutif du programme aéronautique européen Clean Sky ;
- Laurence Lenoir, directrice du département Recherche et applications spatiales du Belgian Science policy office ;
- Yaël Nazé, maître de recherche FNRS à l’Institut d’astrophysique et de géophysique de l’Université de Liège ;
- Jean-François Soussana, président du Haut conseil pour le climat, ancien vice-président International de l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
- Jean-Daniel Testé, président d’Agena Space ;
- Patrick Vincent, ancien directeur général délégué de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
***
La précédente évaluation du Cnes a été réalisée par le Hcéres en 2020. Pour la présente évaluation, le rapport d’auto-évaluation préparé par le Cnes s’est appuyé sur le Référentiel d’évaluation des organismes de recherche du Hcéres ainsi que sur un document ad hoc intitulé « Principaux éléments de problématique pour l’évaluation 2024-2025 du Cnes », qui intègre les attentes du Cnes et celles des ministères de tutelle, et est accessible sur le site internet du Hcéres. Le rapport d’auto-évaluation du Cnes a été livré au Hcéres en septembre 2024. La visite d’évaluation a eu lieu à Toulouse en février 2025, précédée d’une visite de trois de ses membres au centre spatial guyanais en novembre 2024.
Le comité d’évaluation a porté une attention particulière à la réalisation des transformations inscrites dans le Cop 2022-2025, et aux questions liées à la gestion et au développement des compétences au sein de l’organisme. Il a examiné avec soin les questions liées au rôle et aux missions du Cnes, à son positionnement en Europe, en France et à l’international, les activités et les résultats obtenus au cours de la période 2019-2023, ainsi que les sujets de gouvernance, d’organisation, de management et de fonctionnement interne.
***
Le rapport d’évaluation souligne les forces et les atouts du Cnes. Acteur unique en Europe, le Cnes est une des principales agences spatiales au niveau international. Il se distingue par une large combinaison d’expertises, de capacités opérationnelles qui en font une référence mondiale dans le domaine spatial. Il dispose d’une connaissance approfondie et transversale du secteur spatial, de la recherche fondamentale jusqu’aux applications, en passant par les systèmes orbitaux, les lanceurs, l’observation de la Terre, la navigation, les télécommunications, l’exploration et la défense. Ses compétences scientifiques et technologiques de très haut niveau et la très bonne qualité de ses interactions avec les communautés scientifiques sont très largement reconnues. Le Cnes excelle notamment par sa maîtrise du cycle des développements technologiques et ses excellentes capacités de conduite de projets technologiques complexes. Il joue aussi un rôle moteur dans les coopérations spatiales internationales, avec une implication forte dans les programmes européens et de nombreuses collaborations bilatérales. Enfin, le centre spatial guyanais est un atout majeur pour la souveraineté spatiale de la France et de l’Europe grâce à son infrastructure de classe mondiale et son savoir-faire exceptionnel en matière de préparation et d’exécution des lancements.
Cependant, le Cnes fait face à des défis très importants et à certaines difficultés. L’ensemble des évolutions du secteur spatial, et notamment la diversité de plus en plus grande de ses applications, ont conduit à un élargissement fort de la palette des modes d’intervention de l’organisme, et à une multiplication très importante des projets et actions auxquels il participe. Cette situation porte en elle un risque élevé de surcharge pour les personnels et les équipes, d’émiettement des budgets, de dispersion et de perte de qualité, et de dilution des missions les plus essentielles. Surtout, elle conduit à un manque de clarté du « cap stratégique » du Cnes.
Le comité estime aussi que rien ne laisse présager une accalmie pour les prochaines années. Dans un contexte de bouleversements géopolitiques, où les incertitudes restent fortes sur les évolutions des technologies et sur les développements des « marchés » du spatial, la compétition internationale s’accentue et les enjeux de défense liés à l’espace continuent de monter en puissance. Par ailleurs, le changement des équilibres entre le rôle des acteurs publics et celui des entreprises dans le domaine spatial, déjà très visible aux États-Unis, va probablement se poursuivre et s’accélérer. La période à venir s’annonce donc périlleuse et le comité considère qu’il existe un risque réel que le Cnes soit dépassé du fait de la multiplication de ses actions et des bouleversements internationaux.
Un élément majeur aux yeux du comité d’évaluation concerne la situation de l’Europe du spatial, avec le constat simultané d’un fort accroissement de la concurrence intra-européenne entre les États et entre les entreprises, et d’un affaiblissement de l’influence et du rôle de la France et du Cnes dans l’Europe du spatial. Forts de leur légitimité historique, la France et le Cnes, acteur incontournable du spatial européen, ont un rôle déterminant à jouer pour contribuer à surmonter la crise actuelle. Le comité d’évaluation recommande vivement à l’État et au Cnes de proposer de nouvelles initiatives afin de relancer la dynamique spatiale européenne, et de poser les bases d’un plus fort engagement européen du Cnes.
Le comité recommande aussi à l’État et au Cnes d’engager une réflexion approfondie pour recentrer les missions du Cnes sur quelques missions essentielles incluant le soutien à la recherche spatiale et aux développements technologiques risqués, la gestion des infrastructures majeures et une contribution à la régulation du secteur spatial. Il recommande également au Cnes de se doter d’une meilleure capacité à choisir les actions et les projets dans lesquels il s’engage et de veiller attentivement à réduire la dispersion de ses efforts.
Au cours de la période d’évaluation, le Cnes s’est mobilisé à la demande de l’État dans un rôle d’accompagnement des nouveaux acteurs du NewSpace français, au coeur des innovations technologiques majeures du secteur, et la réussite de cet engagement nouveau est saluée par de nombreux acteurs. Une autre réussite de la période concerne le renforcement de l’implication du Cnes dans les activités spatiales de défense, dont le signe le plus emblématique est la coopération étroite développée avec le commandement de l’espace, qui a installé son centre opérationnel sur le campus du Cnes à Toulouse. Le comité d’évaluation salue ces deux évolutions stratégiques.
S’agissant du fonctionnement du Cnes, le comité considère que l’organisme doit finaliser et déployer la démarche de gestion des compétences et en favoriser l’appropriation par les encadrants de proximité et par les équipes, en en faisant un des sujets principaux du dialogue social ; il préconise aussi d’élargir la vision stratégique des compétences spatiales à un cercle de partenaires publics. D’autre part, le comité recommande au Cnes de se doter d’une capacité de pilotage unifié sur les sujets des systèmes d’information, du numérique et des données, et de donner une très haute priorité à l’élaboration et au déploiement d’un schéma directeur du numérique pour répondre aux besoins métiers et assurer la cohérence avec les ambitions en matière d’exploitation des données spatiales. À l’issue de son évaluation, le comité d’évaluation formule 8 recommandations principales adressées au Cnes et à l’État ; elles sont présentées ci-après, et reprises dans chacun des chapitres du présent rapport. Le comité a également identifié les principales forces et faiblesses du Cnes, présentées dans la conclusion du rapport.
Recommandations principales
Comme le prévoient les dispositions législatives fixant les missions du Hcéres, les recommandations du rapport d’évaluation s’adressent au Cnes et, pour certaines d’entre elles, à l’État.
- Recommandation 1 : (adressée à l’État et au Cnes) Construire une vision dynamique des évolutions à cinq ans du secteur spatial, en incluant la perspective de transformation en profondeur des rôles de la puissance publique et des entreprises privées. Élaborer cette vision en associant les communautés scientifiques, les entreprises et les équipes du Cnes, et la partager avec le conseil d’administration, les partenaires et les personnels.
- Recommandation 2 : (adressée à l’État et au Cnes) Engager une réflexion approfondie pour renforcer la capacité du Cnes à être force de proposition et pour recentrer ses missions sur quelques missions essentielles incluant le soutien à la recherche spatiale et aux développements technologiques risqués, la gestion des infrastructures majeures et une contribution à la régulation du secteur spatial.
- Recommandation 3 : Se doter d’une meilleure capacité à prioriser les actions et les projets dans lesquels l’organisme s’engage et veiller attentivement à réduire la dispersion de ses efforts.
- Recommandation 4 : (adressée à l’État et au Cnes) Proposer de nouvelles initiatives pour relancer la dynamique spatiale européenne et poser les bases d’un plus fort engagement européen du Cnes.
- Recommandation 5 : Engager rapidement une réflexion pour la poursuite de l’accompagnement du NewSpace dans les prochaines années, dans une double perspective de structuration de l’écosystème et d’ouverture européenne, et préciser le rôle futur du Cnes dans cette nouvelle étape. 44
- Recommandation 6 : Finaliser et déployer la démarche de gestion des compétences en en favorisant l’appropriation par les encadrants de proximité et par les équipes, et en en faisant un des sujets principaux du dialogue social. Élargir la vision stratégique des compétences spatiales à un cercle de partenaires publics.
- Recommandation 7 : Réaliser une étude détaillée sur la sur-sollicitation des équipes face à l'accroissement des projets, puis élaborer et mettre en oeuvre un plan d’action pour la diminuer en accord avec les priorités stratégiques.
- Recommandation 8 : Examiner avec la plus grande attention la question de se doter d’une capacité de pilotage unifié sur les sujets des systèmes d’information, du numérique et des données. Développer une vision partagée, finaliser un schéma directeur du numérique, et donner une très haute priorité à son déploiement pour répondre aux besoins métiers et assurer la cohérence avec les ambitions en matière d’exploitation des données spatiales.
Forces
- Des compétences scientifiques et technologiques très fortes sur un spectre large, très reconnues en France, en Europe et à l’international. Une implication dans un vaste ensemble de coopérations nationales, européennes et internationales.
- La très bonne qualité des interactions avec les communautés scientifiques, dans ce qui sera désormais son rôle d’agence de programmes.
- La maîtrise de bout en bout du cycle des développements technologiques et les excellentes capacités de conduite de projets technologiques complexes.
- La très bonne connaissance de l’ensemble des acteurs du secteur spatial en France, en Europe et à l’international.
- La bonne interpénétration avec les usages et applications militaires dans le domaine spatial.
- Une implication forte dans les actions d’éducation et de communication vers la société.
- Une mobilisation réussie depuis 2020 pour accompagner les acteurs du NewSpace français.
Faiblesses
- Une faiblesse du rôle européen de la France et du Cnes, au sein d’une Europe du spatial fragmentée.
- Un manque de vision stratégique claire qui se traduit notamment par un élargissement constant des modes d’intervention.
- Une très faible capacité à faire des choix qui conduit à une multiplication des actions et des projets, et à une sur-sollicitation des équipes.
- Une préparation insuffisante des transformations que les mutations profondes et rapides du secteur spatial rendront indispensables dans les prochaines années.
- Une démarche de gestion pluriannuelle des compétences qui reste partiellement déployée au sein de l’organisme et peu appropriée par les équipes.
- Un manque de vision stratégique unifiée sur les sujets des systèmes d’information, du numérique et des données.
- Un défaut persistant d’agilité.