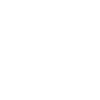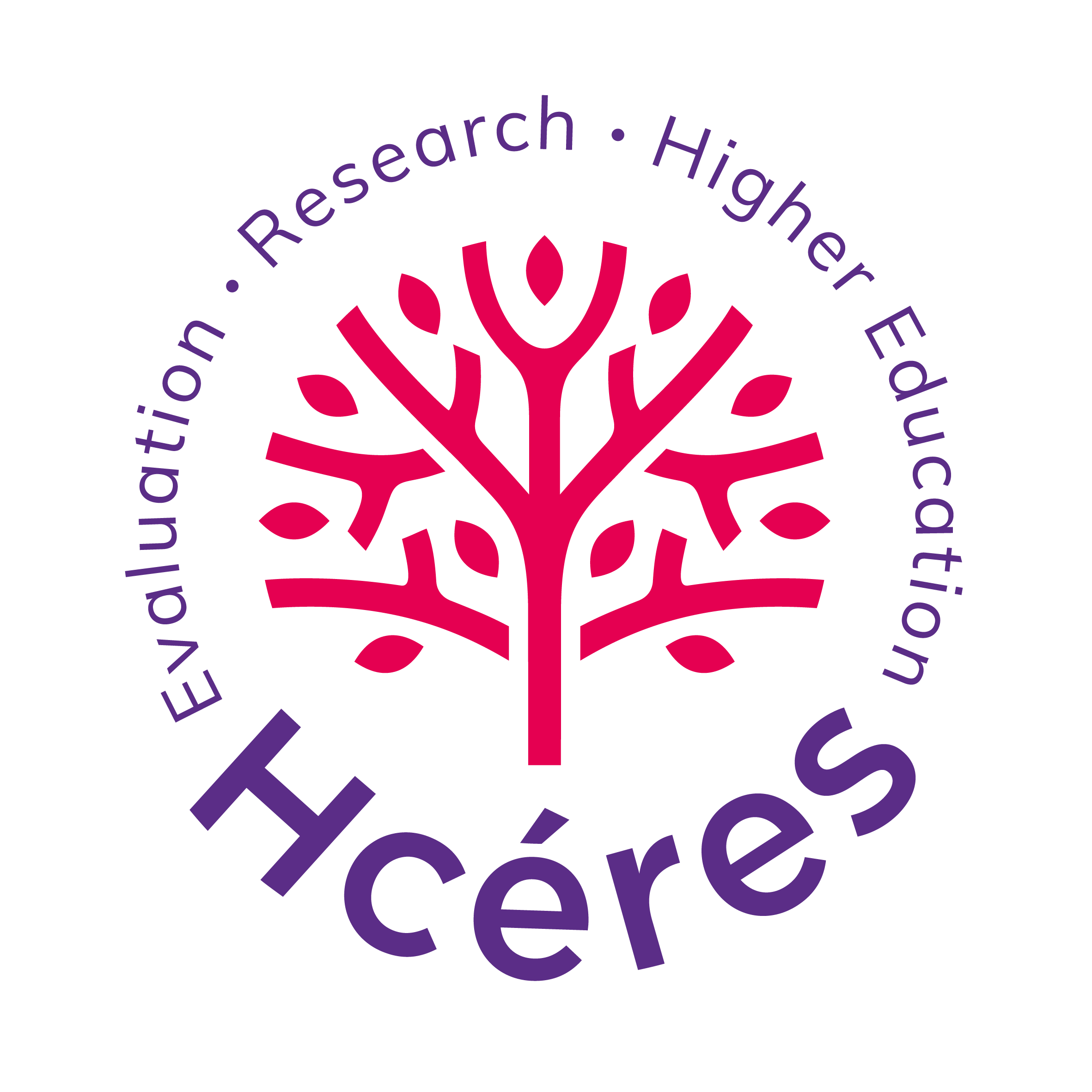Évaluation, Publications
Publication du rapport d'évaluation du CEA
Published on
Le rapport d'évaluation du CEA est rendu public sur le site internet du Hcéres.
L’évaluation a été réalisée par un comité d’évaluation composé de dix membres français et européens reconnus pour leur excellence en matière de recherche scientifique et de développement technologique, et leur expérience de management d’institutions de recherche et d’innovation publiques ou privées.
- Joël Mesot, président de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ, Suisse), président du comité ;
- Caterina Biscari, directrice d’ALBA Synchrotron (Espagne) ;
- Juan Farré, président et directeur général du Danish Technological Institute (DTI, Danemark) ;
- Isabelle Fugier, directrice adjointe des partenariats R&D et de l’engagement des parties prenantes en France dans la division Vaccins de Sanofi ;
- Harry Heinzelmann, Directeur de la technologie du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) ;
- Céline Kermisch, chercheuse et enseignante à l’Université libre de Bruxelles ;
- Cécile Laugier, directrice déléguée en charge de l’environnement et de la prospective auprès de la direction de la production nucléaire d’EDF ;
- Isabelle Moretti, chercheuse à l'Université de Pau et des pays de l'Adour et à Sorbonne Université ;
- Guillaume Poupard, directeur général adjoint de Docaposte ;
- Helmut Schober, directeur général de l'European Spallation Source (ESS - Suède).
***
La précédente évaluation du CEA a été réalisée par le Hcéres en 2020. Pour la présente évaluation, le rapport d’auto-évaluation préparé par le CEA s’est appuyé sur le Référentiel d’évaluation des organismes de recherche du Hcéres ainsi que sur un document ad hoc intitulé « Périmètre et principaux éléments de problématique pour l’évaluation 2024-2025 du CEA », qui intègre les attentes du CEA et celles des ministères de tutelle, et est accessible sur le site internet du Hcéres. Le rapport d’autoévaluation du CEA a été livré au Hcéres en octobre 2024. La visite du comité d’évaluation a eu lieu au CEA à Paris en mars 2025, précédée d’une visite de quatre de ses membres au centre de Cadarache en décembre 2024.
Le comité d’évaluation a porté une attention particulière aux principales évolutions conduites par le CEA depuis 2019, notamment celles qui concernent son positionnement et sa stratégie, au regard des engagements et objectifs du Contrat d’objectifs et de performance (Cop) du CEA avec l’État pour la période 2021-2025. Il a examiné avec soin la politique scientifique et technologique du CEA, ses partenariats dans l’enseignement supérieur et la recherche, le positionnement et les coopérations du CEA en Europe et à l’international, les activités et les résultats obtenus au cours de la période 2019-2023, ainsi que les sujets de gouvernance, d’organisation, de fonctionnement et de culture interne.
***
Le comité d’évaluation salue les actions menées par le CEA pour mettre en oeuvre ses priorités stratégiques dans les domaines de l’énergie, du numérique et de la santé, et la qualité des résultats scientifiques et technologiques obtenus. Ces priorités ont été mises en oeuvre en s’appuyant sur ses compétences historiques essentielles et en maintenant un socle fort de recherche fondamentale. Au cours des cinq dernières années, le CEA a affirmé son identité d’organisme de recherche et de technologie, à l’instar de plusieurs grandes institutions européennes de recherche et d’innovation. Il a également mis en place des outils incitatifs au ressourcement scientifique, à la prise de risque et à la transversalité. La transversalité et l’interdisciplinarité des activités de recherche et développement ont été renforcées, et une ouverture aux sciences humaines et sociales a été initiée. Les activités d'innovation et de transfert technologique, et les collaborations avec les entreprises ont été intensifiées. Dans le même temps, le CEA a continué à renforcer son intégration dans l’écosystème national d’enseignement supérieur et de recherche, notamment en approfondissant ses partenariats avec l’Université Grenoble Alpes et l’Université Paris Saclay.
Le CEA a mené avec beaucoup de constance et de cohérence les transformations nécessaires de l’organisme, en associant l’ensemble de ses entités et de ses équipes. Le comité d’évaluation relève également que le CEA a su, au cours de la période évaluée, préserver et parfois améliorer encore certains de ses points forts historiques, comme sa capacité de pilotage de grandes infrastructures de recherche ; il félicite aussi le CEA pour l’accroissement de son engagement européen, à travers son implication dans les programmes de recherche et d’innovation financés par la Commission européenne et, au-delà, via des partenariats renforcés avec des acteurs leaders en Europe.
Même si certaines transformations lancées ces dernières années sont inachevées, le comité d’évaluation tient à souligner ce bilan remarquable. Il estime que le positionnement actuel du CEA et sa palette d’activités, de la recherche fondamentale aux applications, en lien fort avec les entreprises, avec une capacité accrue à mener des travaux transversaux et interdisciplinaires, le placent en très bonne position pour apporter dans les prochaines années des contributions importantes sur des enjeux majeurs pour la France et l’Europe dans un monde complexe et en constante évolution. Le comité recommande au CEA de poursuivre avec ambition la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques et les transformations engagées, tout en étant attentif aux besoins d’adapter les priorités stratégiques en fonction des évolutions géopolitiques, technologiques, économiques et environnementales.
À l’issue de son évaluation, le comité d’évaluation formule 15 recommandations principales. Il a également identifié les principales forces et faiblesses du CEA.
Recommandations principales
Comme le prévoient les dispositions législatives fixant les missions du Hcéres, les recommandations du rapport d’évaluation s’adressent au CEA et, pour certaines d’entre elles, à l’État.
- Recommandation 1 : Poursuivre les transformations engagées depuis 2019-2020 en étant attentif aux besoins d’adapter les priorités stratégiques en fonction des évolutions géopolitiques, technologiques, économiques et environnementales, et en veillant à accroître l’agilité de l’organisme et sa capacité de ménager des marges de manoeuvre pour pouvoir faire face à des défis imprévus et saisir les opportunités.
- Recommandation 2 : Renforcer les partenariats stratégiques dans le domaine de la transition numérique en France et en Europe avec des institutions académiques, des organismes de recherche et de technologie, et des industriels, pour répondre aux enjeux de souveraineté technologique et de compétitivité.
- Recommandation 3 : Continuer à promouvoir la transversalité et l’interdisciplinarité, poursuivre l'ouverture aux sciences humaines et sociales, et approfondir les réflexions sur les implications sociétales et éthiques des recherches.
- Recommandation 4 : Clarifier l’engagement du CEA dans le domaine de l’énergie nucléaire dans le cadre des nouvelles perspectives pour le développement du nucléaire en France.
- Recommandation 5 : Poursuivre les efforts de redressement du projet de réacteur Jules Horowitz en y accordant une très haute priorité.
- Recommandation 6 : Mener des réflexions et travaux approfondis pour mieux évaluer et mesurer les impacts des activités du CEA sous tous leurs aspects – scientifique, technologique, économique et sociétal – et communiquer sur ces impacts.
- Recommandation 7 : Veiller avec le plus grand soin à la clarté et à la transparence des processus de travail des deux agences de programmes dont le CEA a la responsabilité, et assurer la transparence sur les attributions de financements dans le cadre des programmes qu’elles mettent en oeuvre.
- Recommandation 8 : Donner au conseil scientifique du CEA une composition et un rôle conformes aux pratiques en usage, pour apporter au CEA ouverture académique et internationale.
- Recommandation 9 : Construire un plan d’action pour diversifier les ressources financières d’origine industrielle, notamment en élargissant les partenariats dans les domaines du numérique et de la santé.
- Recommandation 10 (adressée à l’État et au CEA) : Actualiser le cadre budgétaire pour permettre au CEA de moderniser le pilotage de ses activités et de ses moyens, en meilleure cohérence avec sa stratégie, et assouplir la contrainte du plafond d’emplois.
- Recommandation 11 : Poursuivre résolument les efforts de simplification et d’allégement du fonctionnement interne, et la rénovation du système d’information de gestion, afin d’accroître l’efficacité opérationnelle.
- Recommandation 12 : Continuer à accorder à la sûreté nucléaire et la sécurité au sens large la plus haute priorité.
- Recommandation 13 (adressée à l’État et au CEA) : Moderniser la grille de rémunération du CEA.
- Recommandation 14 : Proposer à Inria la mise en place d’un dialogue régulier afin de faciliter la coordination stratégique des deux organismes, de clarifier les complémentarités et de développer les synergies
- Recommandation 15 : Accélérer la transformation numérique du CEA en menant sans tarder, avec la participation d’experts extérieurs, une réflexion approfondie sur la transformation des activités et des métiers permise par l’intelligence artificielle générative, aussi bien pour les fonctions support que pour la recherche et le développement technologique.
Forces
- La cohérence et la pertinence du positionnement et de la stratégie du CEA donnent du sens au vaste ensemble de ses compétences scientifiques et technologiques et fournissent un cadre unifié pour mobiliser ces compétences et développer les synergies internes, Son identité réaffirmée d’organisme de recherche et de technologie, et sa palette d’activités, de la recherche fondamentale aux applications, en lien fort avec les entreprises et avec une capacité accrue à mener des travaux transversaux et interdisciplinaires, le placent en très bonne position pour apporter des contributions importantes sur des enjeux majeurs pour la France et l’Europe.
- Le CEA a montré une très bonne capacité à conduire son projet d’établissement, et à le mettre en oeuvre de façon opérationnelle et en profondeur.
- Les compétences scientifiques et technologiques sont de très haut niveau. L’organisme est en position de leader mondial ou européen dans plusieurs domaines.
- L’ensemble de l’organisme partage une certaine vision, singulière dans le monde de la recherche publique, du « pilotage » des activités de recherche, de leur conduite dans le cadre d’une « approche projet » et de leur suivi.
- L’organisme intègre pleinement l’ensemble des objectifs et des finalités de la recherche publique, de la recherche fondamentale aux pré-développements industriels, en passant par l’appui aux politiques publiques, l’enseignement et la formation par la recherche, l’ouverture à la société, et le déploiement des meilleures pratiques.
- Le CEA dispose d’une très forte capacité, reconnue au meilleur niveau européen et international, à concevoir, construire et mettre en oeuvre des grands instruments de recherche, et à mener des grands projets complexes.
- Le CEA est fortement engagé dans des projets et partenariats européens, au service du renforcement de l’espace européen de la recherche et de la souveraineté scientifique et technologique de l’Europe.
- L’organisme a réalisé des progrès substantiels en matière d’implication dans les sites universitaires de Paris-Saclay et Grenoble.
- Le CEA bénéficie de la confiance de l’État.
Faiblesses
- L’ouverture internationale est d’une ampleur limitée et reste marquée par le positionnement historique du CEA dans les domaines de l’énergie nucléaire et de la recherche en physique.
- La contribution du CEA pour amplifier l’inscription de la science dans la société est faible.
- L’engagement du CEA dans le domaine du nucléaire mérite d’être clarifié dans le contexte des nouvelles perspectives pour le développement de l’énergie nucléaire en France.
- Le dialogue stratégique et les synergies avec Inria sont insuffisants.
- Le modèle économique du CEA est en tension dans un contexte où le poids financier des grandes infrastructures et des passifs nucléaires est très important et où les ressources d’origine industrielle ont diminué, et face à des perspectives difficiles pour l’évolution des dotations allouées par l’État.
- La rigidité de la grille salariale est un frein à l’attractivité et à la modernisation de la politique de ressources humaines.
- Les mobilités interne et externe restent faibles.
- Les hétérogénéités internes persistantes et les lourdeurs liées aux processus de gestion, à la culture et à la grande taille de l’organisme rigidifient son fonctionnement et freinent son agilité. Les améliorations apportées sont lentes et limitées.
- La transformation numérique du CEA est inaboutie, aussi bien pour les activités des fonctions support que pour les activités de recherche et de développement technologique.